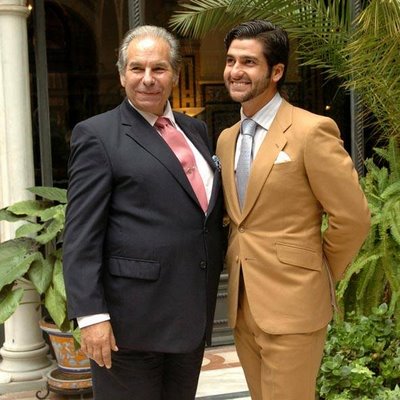Pour l’occasion, elle a dû le repasser avec la chemise à carreau et le bermuda que titillent les chaussettes d'un marron franquiste. Il n’a pas l’air de s’en plaindre et s’active salement sur un bâton rouge dont le seul mérite doit être de lui fermer le clapet. Une chemise rose triste lui dessine les seins, tendus vers cette
"virgen" qu’elle observe d’un œil soumis, comme toutes ces bonnes consciences qui paradent au pied du tas de fleurs. Elle le tient fermement, son gamin qui suce toujours le sucre rouge, et bafouille, dans son rouge à elle, un machin peut-être sincère à cette vierge qui consola Saint Jacques vers 40 après Jésus. La Virgen del Pilar. C’est quand même laid comme nom, faut avouer. Il paraît très pressé. Il doit être espéré par une autre femme aux seins tendus, dans des draps où les prières se meurent. Peut-être. Il court presque et l'effleure. Il est beau, elle ne prie plus, elle contemple.
-
"¡Vamos Merce!" impose le mari qui en a terminé avec son repentir. Pour lui, ça ira pour l’année. Elle bouge sans comprendre, elle doit faire d’autres voeux, les mêmes depuis si longtemps. La loi du désir.
Luis Miguel Encabo, lui aussi, bouge sans comprendre. Il bouge beaucoup trop même. Souvent gratifié au
sorteo dans sa carrière, il joua les danseuses mijorées tout au long de ses trois combats (c'est lui qui affronta le second
toro de López-Cháves). Le premier Cebada Gago est un gentil "mou" sans difficulté apparente mais rien n'y fait, le
diestro est ailleurs, comme un papillon encore timide sortant du cocon. Au dernier, un beau
castaño, Encabo ne profita jamais de la franche noblesse du
bicho et mit tous ses recours à se faire mésestimer d'un public pourtant sympathique. Un papillon mort-né. Passons, mais regrettons cependant de ne pas avoir pu mieux profiter des quelques qualités de 'Segador', le plus franc du lot à n'en pas douter.
Casa Emilio, Avenida de Madrid, Zaragoza (Aragón). Un labyrinthe des passions meurtries. Un repas en famille, un week-end de fête, une vierge qui pousse sur un lit de fleurs déposées en bataille. Les enfants, bien repassés comme l'autre, font tout leur possible pour imaginer des plis à leur anachronique décorum. Les parents, deux couples, entourent la
dueña, rouge vif, même la tronche. Entre les
judias au chorizo, dont se goinfre la plus jeune des mères, et l’
estofado de toro, les regards dessinent les frustations de chacun, les rancoeurs et les peines tues. Le mari en orange, aussi fin qu’un brin d’herbe l’été, s’agace de sa femme au verbe haut et à la croûpe trop large. Elle le dégoûte, elle le sait mais le lui rend bien. On compose devant la marmaille. La
abuela observe, entre deux bouchées gloutonnes, son autre fille s’évapore sans répit dans une fumée grise. Dévorée des yeux par le frustré haineux, la jeune serveuse brune tord son cul pour se convaincre qu’elle existe peut-être, au milieu de ce vide affectif. Y’en a qui déprime, elle, elle remue ses fesses en servant des fayots. Ils iront aux
toros tout à l’heure parce qu’il a l’
abono ! Il lui coûte cher mais peu lui chaut, il peut se le payer, il le clame, vautré sur une chaise abîmée, les yeux ferrés par un cul inconnu. Puis, les femmes partent avec les marmots, la serveuse débarrasse et les beaux-frères restent assis là, en compagnie d'un silence coutumier depuis quelques années. Le plus discret des deux a regardé sa femme au travers de la porte vitrée comme un chien perd son maître. Muet. Lui se disait encore,
"hable con ella".
Vers 20h, dans sa chambre d’hôtel, Fernando Cruz s’est signé et a causé pendant des heures avec elle, la Virgen del Pilar, ou une autre, l’offre ne manque pas en Ibérie. Il lui a raconté tout, n’importe quoi, et son visage blanc, sillonné, raviné par la peur et l’effort a reconquis ses lignes du demain, de l’espoir. Fernando Cruz est une révélation de la
temporada, surtout en Espagne d’ailleurs. Il s’est fait remarquer à Madrid, Pamplona, Bilbao et au final à Zaragoza.
Tarde immense en blanc de vierge. Dans son
traje superbe, il a fait rendre l’âme à 100 000 ongles, un millier de
puros et a vieilli une assistance de quelques années-lumière. Tout ça pour deux
toros. Son premier, 'Esquilo', est un faiblard à peine et mal piqué par Rafael Sauco. Difficilement entrepris par une cuadrilla très moyenne toute la course, le
cebada affirme ses carences lors du
tercio de banderilles mais sa caste le tient droit et Fernando espère. Depuis les
medios, il cite ferme et 'Esquilo' galope vers le leurre. Quatre
doblones comme des acacias, le genou à l’équerre, le bras bourreau tendu, quatre écartèlements, quatre morsures profondes. Un requin blanc ! 'Esquilo' ne supporte pas et s’arrête, rendu par sa faiblesse, écoeuré par un tel traitement quand la beauté devient supplice. C’est là tout le problème de Fernando Cruz. Dominateur dans l’âme, dans sa technique, il ne fait pas encore la part entre ces
toros si communs qu’il convient de "choyer" et ceux, plus habituels pour lui, qui demandent torsion voire même contorsion. Il apprendra, espérons-le.

'Delincuente', n°32, restera longtemps dans les arcanes de sa mémoire. 564 kgs de mal. Une demie-tonne d’effroi, une parure de mort. Mal piqué encore, déjà fuyard, il fond sur les premiers châtiments de ce pâle visage, une fusée au cul. L’entame est fabuleuse et Cruz, croisé, angle droit surtendu, le plie, le tord sans rompre.
Querencioso, 'Delincuente' décide seul du lieu de la bataille. Aux planches ! Fernando accepte et joue son sort, c’est un requin en apnée, une incohérence. Chaque passe est scandée par les cris, les « houuu », les « ahhh », un délire sans joie. Il n’y a pas de guerre propre.
Il a survécu, sans corne dans le corps, mais il devra réapprendre à respirer. Pour sa part, Felipe Barrera Parra,
mayoral des
toros de la "Zorrera", a dû sentir tout le poids de son feutre anthracite. Ce n’était plus la peine de prendre des notes ; de toute façon, il connaissait tout sur sa mère, elle mourra dans quelques heures, c’est certain.
A cinquante mètres de la Plaza del Pilar, presque à l’ombre des toits de tuiles multicolores, une petite rue annonce la fin des apparats de ce catholicisme de vitrine. Les visages moins lisses, plus colorés, racontent d’autres tropiques et de plus rudes vies. Le minuscule bar à la façade verte, surchauffé de musique et de rires enivrés, est gardé par trois femmes, trois "filles", trois cicatrices. Ce sont peut-être de nouvelles Pepi, Luci et Bom perdues dans la fadeur de la capitale aragonaise. Ce qui est sûr, c’est que ce sont bien des filles du quartier. Celle qui nous sourit est noire, le cheveu tiré à se rompre, les épaules larges et le gras protecteur. Elle tente une pose aguicheuse contre le mur jauni. De l’autre côté de la rue, une grande et grosse femme, noire ou métis elle aussi, palabre sévère avec une caricature rousse, sans dents, des galets dans la gorge. Elle ressemble à ces vieilles putes que dessinait Reiser. La géante métis ne cache pas ses yeux tuméfiés et violets ; il y a en elle un côté « Agrado », le transsexuel « authentique ». Elle doit raconter son histoire à la rousse rocailleuse qui écoute en clopant. L’autre sourit toujours, figée contre son mur. Un contraste, si peu de mètres, l’humanité dans tous ses atours.
'Segadillo', n°96, 540 kg de noire
mansedumbre encastada. Et pas qu’un peu ! Atrocement piqué par Juan Aguilar Granada lors du deuxième assaut, carioqué à outrance, lacéré dans l’épaule, il court comme un guépard après la moindre mouche. Domingo López-Cháves, autre grande révélation de l’année (souvenez-vous de son affrontement avec les
frailes de Bayonne), décide de mettre en valeur cette mobilité extrême et d’entamer au centre, sans doubler le
gago. L’émotion est immédiate, très intense évidemment mais la charge est trop vive et ne s’atténue pas. Le matador de Salamanque s’arrime, parfois bien décentré, d’autres fois inesthétique (naturelles forcées) mais sincère, courageux. La première série à droite l’avertit qu’il ne faut pas trop jouer, le
toro lui gueule sa mauvaise éducation un peu trop fort et Domingo prend à gauche où l’animal se sent plus sain. En confiance, Cháves répète à droite, la charge s’accélère et la cheville s'enrhume du vent froid du diamant. Ça ne loupe pas et 'Segadillo' perfore Domingo à la passe suivante, laidement, dans le haut de la cuisse. Le bas rose se fend d’une large traînée noire qu’un garrot blanc essaye de contenir. Le temps d’achever le labeur, le temps de dire au revoir à sa belle saison et López-Cháves quitte le cénacle en n’oubliant pas d’embrasser une brune sur le chemin du bistouri.
Comme les fleurs de la vierge de Saragosse, la
temporada 2006 se fane avec les jours qui deviennent aujourd'hui plus vite nuit. Déjà, pensant à 2007, on se dit qu’il faudra revenir voir des
toros parce que c’est là au fond de nous.
¡Volver!